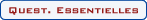17 novembre 2025 -
Sainte Elisabeth de Hongrie
17 novembre 2025 -
Sainte Elisabeth de Hongrie
Vous êtes ici:
Culture
» Regard chrétien sur l’art contemporain
AnalysesRegard chrétien sur l’art contemporainMon jugement sur l’Art Contemporain, à l’occasion de la messe de requiem de Marie-José de Bravura (Homélie de l’Abbé Eric Iborra, donnée à l’église Saint Eugène, Paris)Il y a trois mois presque jour pour jour, beaucoup d’entre vous, j’imagine, se retrouvaient au carmel de Fontainebleau pour confier à Dieu, dont c’est le propre de faire miséricorde - comme le dit la collecte de la messe de funérailles - l’âme de Marie-José de Bravura qui venait de succomber à une attaque cérébrale quelques jours auparavant. Précisément un 11 octobre. Et cela n’est peut-être pas sans signification. Parce que le 11 octobre l’Église fête la maternité divine de la bienheureuse Vierge Marie. Quel rapport, me direz-vous, avec Marie-José ? Eh bien, j’y vois un clin d’œil de la Providence au regard de son activité de sculpteur et d’essayiste. Marie-José avait commencé par faire du droit. Le droit, on le sait, ça mène à tout. Moi, cela m’a conduit à cet autel. Elle, cela la conduisit assez vite à la sculpture. Travaillant essentiellement sur un matériau ancien, le bronze, et sur un autre, plus moderne, la résine, elle dit un jour, parlant du modèle en terre glaise qui précède le façonnage de l’œuvre monumentale, que « ce ne fut pas un hasard si Dieu prit de la terre pour faire son chef d’œuvre ». Nous y voici. Car la maternité divine de Marie, qu’est-ce donc sinon le commencement d’une nouvelle genèse, de cette genèse inouïe qui voit Marie tisser en son sein celui que l’Apôtre appelle le second Adam, celui qui vient reforger au feu de sa charité, divine, les fragments de ce malheureux premier Adam, brisé par l’hybris mortifère du péché. Si Adam veut dire en hébreu celui qui est fait de glaise, alors Marie est la nouvelle terre, précieuse et pure, de laquelle l’Artiste divin sculpte celui que l’Ecriture appelle le plus beau des enfants des hommes, lui qui est aussi, dans son être le plus profond, le Verbe éternel, le Logos divin, comme le rappelle le dernier évangile dans la messe. L’artiste divin, pour réparer son œuvre initiale, brisée par le péché, produit son chef d’œuvre, le Christ. Et la contemplation du mystère de l’incarnation, dans le Christ, peut nous aider à mieux comprendre le sens que revêtent les arts d’ici-bas, et en particulier les arts plastiques. Car dans le Christ - et c’est le message de Noël et de l’Epiphanie que nous venons de célébrer - le fond rayonne dans la forme qui se donne à voir. Le verbe έπιφαινω exprime l’irradiation vers l’extérieur d’une réalité intérieure, la manifestation jusqu’à la surface d’une richesse qui se trouve dans les profondeurs. La matière est le lieu d’apparition de la forme. Et ce qui est vrai de tout être de la nature l’est encore davantage de cet être unique qu’est l’homme, esprit incarné, esprit qui s’exprime dans la matière dont il fait son corps. Cette structure apparaît au plus haut point lorsque Dieu lui-même, dans le Verbe, vient habiter cette glaise dont nous sommes faits. Glaise dont l’intelligibilité est alors surélevée. C’est vraiment le Logos divin qui irradie le second Adam, à l’image duquel nous, les héritiers du premier, sommes reforgés, reconstruits, réédifiés. C’est cette structure - hylémorphique diraient les philosophes - que l’artiste, et en particulier le plasticien, met en lumière. Son art, c’est de faire voir ce qui n’est plus vu, ce qui implique parfois de forcer le trait, comme l’abstraction figurative le fait. La sculpture ne se ramène pas au moulage, pas plus que la peinture à la transcription photographique. Et c’est ici que se situe le second aspect de l’œuvre de Marie-José de Bravura, l’essayiste qui a rompu des lances avec l’Art Contemporain. Car l’artiste, dans cette perspective, se comprend, comme le disait Tolkien en littérature, comme un subcréateur. Créer, pour l’artiste, ce n’est pas créer absolument, c’est faire apparaître la vérité et la beauté que recèle l’être. L’œuvre a un côté pédagogique : en magnifiant le réel, elle fait apparaître ce que l’œil habitué ne sait plus voir. Elle se tient au service du Logos qui, médiateur de la Création, est partout présent dans le créé comme sa raison ultime. La rupture du dialogue avec l’Autre par excellence, avec Dieu, a provoqué dans notre société une dévalorisation de l’altérité comme catégorie, malgré les apparences, ce qui a conduit à une dissolution de la communauté, à une atomisation de la personne, pour aboutir, dans bien des cas, à l’enfermement mortifère du moi, à une sorte d’autisme existentiel. Le monde des arts en constitue l’illustration malheureuse, et à certains égards paroxystique, précisément à cause de la plus grande sensibilité de l’artiste. La décadence que constitue l’AC est le signe révélateur d’une société moribonde. Ce nombrilisme pathétique de tant de performances subventionnées par l’art officiel n’est que l’expression de la vacuité d’une culture qui a répudié son origine. Car une société qui renie ses racines est comme une rivière qui s’affranchit de sa source : elle devient un marécage putride. Nous n’en sommes pas loin aujourd’hui, et la puanteur d’un certain AC est là pour nous alerter ! Car qu’est-ce que l’AC sinon le triomphe du nihilisme, expression d’un moi incapable de s’inscrire dans une relation constructive avec le passé, avec l’autre, avec l’absolu. Permettez-moi de rappeler des souvenirs personnels. Comme aumônier de la Salpêtrière pendant dix ans, j’ai vu défiler toutes sortes de réalisations, absconses aurait dit Marie-José. Absconses et désespérantes, mais fidèles reflets d’une société où les philosophes à la mode jouent à déconstruire le monde. Déconstruire, disait encore Tolkien, c’est l’œuvre d’un cerveau où les rouages ont remplacé l’esprit. A force de déconstruire l’être, la philosophie, l’histoire, les valeurs, il ne reste plus rien sur quoi bâtir sa vie. Quoi d’étonnant alors au fait que nos plasticiens participent de cette impuissance et la reflètent ? Incapables de créer, ces impuissants ne sont plus capables que de décréer, de salir ce qu’ils ne savent même plus imiter. Car l’artiste contemporain est bien trop imbu de sa supériorité bourgeoise pour apprendre un savoir-faire qui l’apparenterait à un artisan ! Non, son impuissance, il la maquille sous une logorrhée vaniteuse, absconse en un mot. Et comme ce qu’il produit n’a pas plus de consistance qu’un excrément, il l’applique à ce qui en a, l’œuvre classique. Les moustaches de la Joconde ! Ou ces réalisations prétentieuses pensées exprès pour inverser le sens d’œuvres belles, comme la chapelle de la Salpêtrière, la façade des Invalides, et j’en passe. L’AC entendu de cette manière tombe sous la définition du mal donnée par la métaphysique aristotélicienne : une privation d’être, un néantement de ce qui est, un parasite, une inversion hideuse de l’œuvre divine, qui elle est pleine de sens et d’intelligibilité. Quand les talents humains sont mis au service d’un moi aux aspirations sécularisées et égocentriques, il se produit une perte de la dimension épiphanique d’autrui et du cosmos. Le monde n’est plus qu’une carrière de matériaux, la société un réservoir de main d’œuvre, l’un et l’autre à exploiter. Cette instrumentalisation de la personne et de la nature est aux antipodes de l’art véritable. Et elle aboutit à la déshumanisation monstrueuse des législations européennes actuelles. Ce n’est pas pour cet art que Marie-José vivait et luttait, mais bien plutôt pour cet art divin dont tout artiste authentique est, volens nolens, le serviteur et que la liturgie exprime si merveilleusement dans la préface de la Nativité : « La révélation de votre gloire s’est éclairée pour nous d’une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s’est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible ». L’artiste est ainsi comme la bienheureuse Vierge Marie : celui qui nous donne le chef d’œuvre où rayonne davantage la splendeur incréée pour que celle-ci nous arrache à notre pesanteur et nous entraîne vers elle. Puisse le Christ, chef d’œuvre absolu de Dieu, recevoir en ses parvis celle qui s’est humblement efforcée, dans son art, d’exprimer la beauté et la vérité qui gisent au cœur de l’être ! Abbé Eric Iborra, vicaire à Sainte Eugène - Sainte Cécile (Paris IXe) |